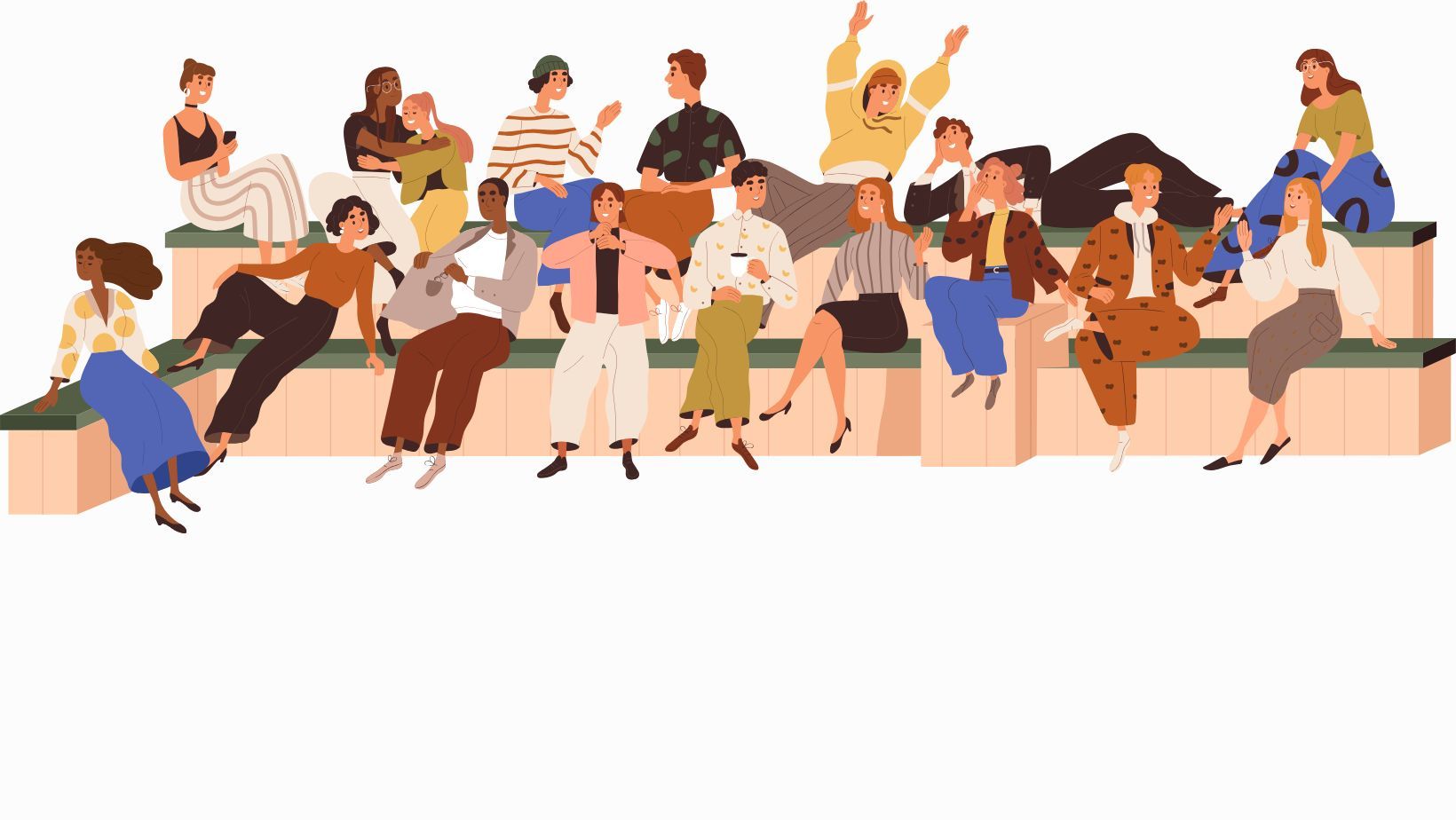Vous avez probablement constaté que l’équipe de la FFMAS se cherche depuis quelques temps en matière d’écriture inclusive. En effet, pour s’adresser à son public à très grande majorité féminin elle s’est questionnée sur la neutralité de l’usage du masculin générique comme en écho à l’énigme suivante :
Un garçon de treize ans est en voiture avec son père quand ils ont un accident. Le père meurt sur le coup et le fils est transporté d’urgence à l’hôpital.
La solution proposée il y a plusieurs années était : le chirurgien est sa mère… Aujourd’hui, elle pourrait aussi être, c’est son second père.
Le meilleur chirurgien de l’hôpital est appelé en urgence pour l’opérer, mais au moment où il entre dans la salle d’opération il voit le garçon et dit : « Je ne peux pas l’opérer, c’est mon fils » comment est-ce possible ?
Dans la nouvelle revue – éducation et société inclusives n° 93 de janvier 2022, le CAIRN a retenu la définition de l’écriture inclusive de Julie Moynat, créatrice du site La Lutine du Web.
« L’écriture inclusive désigne les différentes pratiques d’écriture destinées à inclure autant les femmes que les hommes dans les écrits. On n’écrit plus majoritairement au masculin, mais de façon égale au masculin et au féminin »
Mon but n’est pas de polémiquer sur ce sujet qui me tient à cœur. Il s’agit davantage de représenter la contribution des femmes à la vie professionnelle et à l’espace public en général au même niveau que celle des hommes. Et par extension, favoriser la visibilité de nos métiers essentiellement féminins tels que les notres.
Pour débroussailler le sujet, je vous propose un point non exhaustif sur les avis actuels, quelques définitions, des pratiques inclusives et enfin le lien avec l’égalité professionnelle en entreprise.
Point sur les avis
Contre
L’Académie française, dans sa Lettre ouverte sur l’écriture inclusive pointe entre autre le fait qu’elle aurait pour effet d’aggraver les inégalités, et que sa correspondance avec l’oralité est impraticable pour la qualifier de dissuasive de l’usage du français comme langue véhiculaire.
Dans sa Circulaire du 5 mai 2021 – confirmée par un arrêt du Conseil d’État du 20 décembre 2024 – le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports maintien le masculin au sens générique. Il maintient la conformité aux règles grammaticales et syntaxiques et proscrit le recours au point médian tout en préconisant la féminisation des métiers et fonctions.
Neutre
De mémoire, Christophe Benzitoun* du collectif des linguistes atterrés s’était montré réservé sur certaines formes de cette écriture lors du webinaire de la semaine des métiers 2023. Il s’était aligné sur les positions de l’ouvrage Le français va très bien, merci, paru aux Tracts Gallimard. Ce collectif y dénonce le fait de figer notre langue et plaide pour son évolution perpétuelle et l’apport de l’usage majoritaire.
Pour
De nombreuses publications en linguistique comme en science de l’éducation démontrent que le masculin n’est pas neutre pour le cerveau (Cf. l’article du CNRS L’écriture inclusive par-delà le point médian de février 2024 et ses références bibliographiques).
De plus, le Haut-Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes a actualisé en 2022 son Guide pratique Pour une communication publique sans stéréotype de sexe dont nous recommandons la lecture.
Enfin, nous n’oublions pas que 300 millions de locuteurs partagent notre langue française comme le précise l’article sur la Cité internationale de la langue française « Le français à travers le monde ».
Vocabulaire de l’écriture inclusive
Avant tout, voici quelques définitions associées à l’écriture inclusive.
- Doublet
Formulation masculine et féminine d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif l’une à côté de l’autre.
- Doublet abrégé
Combinaison de la forme féminine et de la forme masculine d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif dans laquelle les terminaisons genrées sont séparées au moyen d’un signe typographique. Après quelques années d’usage, le point médian (·) semble dominer. On l’obtient par alt 0183 sur PC et option + maj + F sur Mac.
- Écriture inclusive
Ensemble de principes et de procédés favorisant l’inclusion et le respect de la diversité dans les textes et permettant d’éviter toute forme de discrimination, qu’elle soit fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, la race, l’origine ethnique, les handicaps ou tout autre facteur identitaire.
- Épicène
Se dit d’un mot qui s’emploie tant au féminin qu’au masculin, sans changer de forme, ou qui n’a qu’un seul genre grammatical, mais peut désigner des personnes de tous les genres.
- Générique
Dans le contexte de l’écriture inclusive, se dit d’un genre grammatical qui englobe l’ensemble des genres.
- Iel ou ielle
Pronom personnel neutre de la troisième personne auquel s’identifient certaines personnes non binaires.
- Néologisme
Terme nouveau dont l’usage n’est pas généralisé ou terme employé dans un sens nouveau.
- Neutre
Dans le contexte de l’écriture inclusive, se dit d’un mot ou d’une formulation qui n’indique pas le genre des personnes dont il est question ou auxquelles on s’adresse.
- Nom collectif ou collectif
Nom, généralement singulier, qui sert à désigner un ensemble de personnes sans aucune référence à leur genre.
- Point médian
Point placé au-dessus de la ligne (·), employé pour former un doublet abrégé dans le contexte de l’écriture inclusive.
Pratiques inclusives
Nous avons déjà admis des formulations inclusives pour remplacer mademoiselle, le nom de jeune fille ou nom d’épouse par madame ou nom d’usage. Depuis 2002, la loi impose de remplacer l’expression nom patronymique par nom de famille.
Avant d’être normative, l’écriture inclusive est plus largement une démarche. Certains noms, mais aussi des adjectifs et des pronoms s’emploient tant au féminin qu’au masculin, sans changer de forme. Ces mots sont dits épicènes.
Noms épicènes
Ce sont par exemple : modèle, célébrité, sommité, personnage, personnalité, sommité, spécialiste… On les trouve aussi parmi les terminaisons en -aires (gestionnaire), -graphe (démographe), -ique (scientifique), -iste (archiviste), -logue (sociologue).
L’une des pratiques répandues consiste à utiliser le pluriel pour supprimer la marque du genre (le fonctionnaire devient les fonctionnaires) tout comme les déterminants neutres (les, des : exemple un cadre devient les cadres).
Si l’on ne peut pas utiliser de formulation neutre (les équipes doivent en référer à leur manager), les pronoms de reprise doivent être mis au féminin et au masculin (c’est-à-dire sous forme de doublets).
| Nom épicène à privilégier | Nom genré à éviter |
| Adepte | Amateur |
| Aide | Assistant |
| Architecte | Concepteur |
| Automobiliste | Chauffeur, conducteur |
| Cadre, manager | Directeur |
| Membre | Participant |
| Porte-parole | Représentant |
| Responsable | Superviseur |
| Scientifique | Chercheur |
| Spécialiste | Expert |
| Tous niveaux d’expérience acceptés | Jeune diplômé |
Adjectifs et pronoms épicènes
On peut remplacer un adjectif variable en genre par un adjectif épicène qui permet d’exprimer la même idée (apte, authentique, autonome, calme, difficile, dynamique, efficace, intègre, indispensable, novice, responsable, serviable, sympathique, utile…).
De même avec de la pratique les pronoms épicènes viendront plus facilement (beaucoup, d’autres, la plupart, n’importe qui, on, personne, peu, plusieurs, qui, quiconque, vous…).
| Adjectif épicène à privilégier | Adjectif genré à éviter |
| Aimable | Gentil |
| Autonome | Indépendant |
| Charitable | Généreux |
| Dynamique | Actif |
| Enthousiaste | Enthousiasmé |
| Fiable | Sérieux |
| Agile | Réactif |
| Habile | Adroit |
| Méthodique | Rigoureux |
| Moderne | Contemporain |
| Neutre | Impartiaux |
| Stable | Constant |
Doublets
Le doublet consiste à écrire l’une à côté de l’autre la forme masculine et la forme féminine d’un nom, d’un pronom ou d’un adjectif.
Dans son Guide pratique pour une communication publique sans stéréotype de sexe, le haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes conseille de pratiquer l’ordre alphabétique, arbitraire, il privilégie tantôt un genre, tantôt l’autre (exemples : les sénateurs et les sénatrices, mais les collégiennes et les collégiens).
Le point médian (alt 0183 sur PC ; option + maj + F sur mac)
Beaucoup plus discret que les parenthèses ou les barres obliques, le symbole point médian a le mérite de ne pas être attribué à une autre fonction dans notre langue. Son usage semble se stabiliser dans une forme simplifiée plus compacte et lisible.
Il s’agit de le positionner entre la marque du masculin et l’ajout de la terminaison au féminin. Par exemple les salarié·es, les candidat·es, tous·tes les participant·es, les rédacteur·ices. À l’oral ce dernier se transforme en doublet : « tous les participants et toutes les participants » ou « les candidates et les candidats », plus rarement les « rédacteurices ».
Accords en genre et en nombre
L’usage de l’accord de proximité revient pour une plus grande simplicité. De même que l’on accorde le genre au plus grand nombre.
Images inclusives
La représentation féminine est aujourd’hui plus équilibrée dans les médias d’information ou encore dans les publicités des métiers du bâtiment, de l’armée ou de grandes marques. À la FFMAS, nous essayons de retenir des images inclusives de femmes et d’hommes représentant la diversité de nos métiers y compris dans les tenues vestimentaires dans toutes nos présentations.
Lien avec l’égalité professionnelle en entreprise
Par-delà les polémiques de langage, l’égalité professionnelle inscrite dans la loi passe par une communication égalitaire dont les objectifs sont :
- la visibilité et la reconnaissance identiques des femmes et des hommes et laisse une place implicite à d’autres identités.
- la féminisation des candidatures et contribue à une meilleure mixité des équipes.
- Le renforcement du sentiment d’appartenance, de l’engagement et de la cohésion d’équipe.
- la projection d’une image de modernité et la contribution à la marque employeur.
- La réduction des biais inconscients en aidant à déconstruire les stéréotypes.
Le ministère du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles propose un guide Pour une communication publique sans stéréotypes de sexe à destination des TPE-PME pour lever les freins liés aux stéréotypes et favoriser le développement de plans d’action en faveur de l’égalité professionnelle.
Conclusion
J’espère avoir a minima détendu votre approche globale sur le sujet et surtout débarrassé l’expression « lecture inclusive » de l’interprétation erronée dont elle est affublée par ses contempteurs. En effet, l’inscription de cette démarche dans le concept d’égalité professionnelle, entrant elle-même dans le champ de la Responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE, ou RSO quand il s’agit d’une organisation).
Il y a tout à gagner à l’adopter, même s’il n’existe pas de processus dédié dans la structure. Qui pourrait le reprocher ? Cela peut simplement commencer par le remplacement de formulations ou d’images différenciantes dans vos écrits par des expressions et images inclusives.
Attention toutefois à respecter la culture de la structure et son environnement pour ne pas détonner. En cela, l’usage du point médian n’est pas obligatoire si l’on peut ou doit s’en tenir aux doublets ou à un vocabulaire épicène. Pour commencer, il vaut mieux proposer des formulations et images à sa hiérarchie en explicitant, argumentant et documentant la démarche.
D’ailleurs, cette démarche apporte une touche d’implication supplémentaire dans le positionnement professionnel, donc de sens au travail. Cela peut même donner de la visibilité à la contribution des assistantes à la marque employeur, surtout si l’on va jusqu’à partager la démarche par la formalisation par écrit.
La balle est dans votre camp, à vous de « jouer » !
Maryse EBALLARD
Experte métier
PS : Gageons que le futur nous éclairera sur le développement de l’usage des néo-pronoms tels que iel et ielle qui ne sonnent pas encore juste à toutes les oreilles !
Pour aller plus loin
- CNRS : l’écriture inclusive par-delà le point médial
- Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes : Guide pratique pour une communication publique sans stéréotypes de sexe
- Arte : Vidéo
- Gouvernement du Canada : Noslangues-ourlangages.ca
- Essai : Non le masculin ne l’emporte pas sur le féminin, Élianne Viennot, éditions ixe